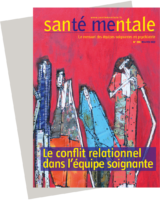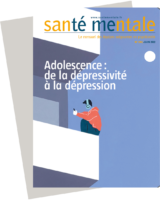Choisir librement son médecin ou son établissement de soin fait partie des droits fondamentaux du patient : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé (…) est un principe fondamental de la législation sanitaire », indique le Code de la santé publique (1). Le médecin doit donc respecter le choix du patient et au-delà « lui faciliter l’exercice de ce droit » (2) . Ce principe du libre choix peut cependant être limité par des considérations d’ordre techniques ou financières. C’est-à-dire si l’établissement choisi par le patient ne délivre pas les soins spécifiques dont il a besoin, ou encore si lorsque le coût lui paraît trop élevé, en lien avec le remboursement de l’Assurance maladie et des mutuelles (établissements privés, médecins non conventionnés). La loi précise : « Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités tech- niques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. » (1).
Les spécificités de la psychiatrie
L’organisation de l’offre de soins en psychiatrie publique s’appuie sur le principe de la sectorisation, découpage géographique et démographique visant à offrir des soins de proximité. Pour autant, le principe général s’applique et tout patient suivi en psychiatrie dispose du droit au libre choix de son établissement de santé mentale et de son médecin psychiatre.
Ce droit, consacré légalement pour les patients souffrant de troubles mentaux depuis 1990, est codifié à l’article L.3211-1 du Code de la santé publique : « Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. »
Notons que le ministère de la Santé a précisé en 1991 que la sectorisation a été mise en place « afin que le malade dispose toujours d’une prise en charge au plus près de son domicile », précisant qu’elle n’est pas « un argument pour refuser la prise en charge d’un malade situé dans le ressort d’un autre secteur » (3). Les patients hospitalisés en soins libres et en soins à la demande d’un tiers bénéficient ainsi du droit au libre choix. Les limites de l’exercice de ce droit concernent les personnes ayant été admises en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État et les personnes détenues.
Soulignons que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) incite au respect du droit au libre choix du praticien, ce qui suppose implicitement l’information relative à ce
droit : « Le CGLP recommande que, dans la mesure du possible, les patients puissent avoir le libre choix du psychiatre dès lors que plusieurs d’entre eux exercent au sein de la même unité » (4). Relevons néanmoins que la déontologie médicale permet au médecin de refuser de suivre un patient qui en ferait la demande, sauf urgence et à condition d’en motiver le bien-fondé : raisons professionnelles (manque de lits…) ou personnelles (différend avec l’intéressé et/ou sa famille, option de conscience dans certains cas). « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. (…) Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins » (5).
Le Code de la santé publique précise aussi qu’« en cas de refus d’admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l’établissement permettent de le recevoir, l’admission peut être prononcée par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS). » (6)
Choisir et consentir
Contrairement à une idée reçue, le patient hospitalisé en établissement de santé mentale n’est pas tenu d’être pris en soins dans une structure selon son lieu d’habitation. Un refus médical opposé doit être motivé par une incapacité matérielle que le directeur général de l’ARS est en droit de vérifier. Il est permis de penser que l’ancrage fort dans les mentalités du découpage territorial a eu pour effet de considérer qu’une personne ne pouvait être hospitalisée qu’au sein de « son secteur ».
En pratique, le respect du libre choix du médecin et de l’équipe soignante reste un principe difficile à appliquer, alors qu’il parait une condition indispensable notamment pour consentir aux soins (7).
Valériane Dujardin-Lascaux Juristes, EPSM des Flandres.
1– Article L.1110-8 du CSP.
2– Article R.4127-6 du CSP.
3– Fiches du ministère chargé de la Santé en date du 13 mai 1991 relatives à l’application de la loi de 1990 publiés au BO n° 91/24 (pages 19 à 35).
4– Rapport annuel CGLPL, 2014.
5– Article R.4127-47 du CSP.
6– Article R.1112-12.
7– Lire aussi à ce sujet : Le libre choix du médecin en psychiatrie, condition indispensable du consentement aux soins, J.-M. Panfili, 2 8 2012, site de Santé mentale, rubrique Reçus à la rédaction.